Cartographie des processus : pour naviguer vers l’efficacité opérationnelle

Victoire Bejjani, rédactrice
chez Pratiques RH
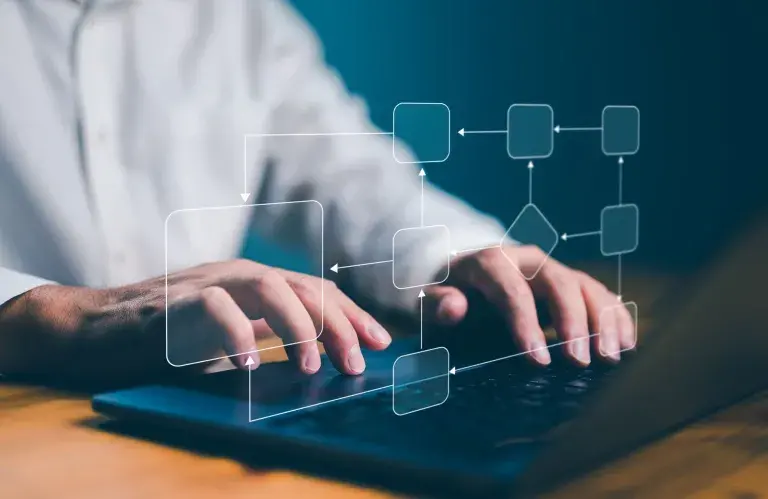
Dans bien des milieux de travail, les journées s’enchaînent. Les décisions se prennent en mode réflexe, les urgences dictent le rythme, et les méthodes restent celles qui « ont toujours fonctionné ».
Pourtant, une approche peut radicalement améliorer l’efficacité collective : la cartographie des processus.
La cartographie des processus, c’est quoi ?
Un terrain de camping immense, traversé de sentiers qui s’entrecroisent, jalonné de raccourcis invisibles et de détours boueux. Sans carte, difficile de repérer les bons passages ! Encore plus lorsqu’il faut éviter les zones fermées ou mal balisées.
Et ce n’est pas qu’une simple métaphore. « La cartographie, c’est le point de départ de toute démarche d’amélioration continue », affirme Luis Angel Palma, directeur principal, Processus et performance à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).
Son expertise en transformation organisationnelle rappelle une vérité simple : sans carte structurée, même les meilleures intentions peuvent tourner en rond.
D’ailleurs, une étude de la Banque de développement du Canada (BDC) souligne que l’absence de processus clairs et de systèmes bien établis freine la croissance de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes.
Ce flou opérationnel complique non seulement la gestion quotidienne, mais peut aussi nuire à la pérennité de l’organisation, notamment lorsqu’il est question de l’adapter, de la faire évoluer... Ou même de la vendre.
D’où vient la cartographie des processus ?
Née dans les usines du XXe siècle pour éliminer les pertes de temps, la méthode a été formalisée par Frank et Lillian Gilbreth en 1921. L’ASME (American Society of Mechanical Engineers) standardise ensuite les symboles devenus universels.
Ce que révèle une bonne lecture des processus
« La cartographie des processus sert à définir le chemin optimal, clarifier les responsabilités et repérer ce qui crée de la valeur pour les clients comme pour les équipes, explique Luis Palma. Elle donne une vue d’ensemble et permet d’ajuster le parcours selon la réalité du terrain. »
Concrètement, cette démarche permet de :
- Réduire les zones de surcharge et les pertes de temps
- Optimiser les ressources sans passer par de nouvelles embauches
- Mieux reconnaître et mobiliser les expertises déjà en place
- Planifier les besoins en formation : pour permettre à chaque employé.e d’avancer
« Ce qu’on ne voit pas, on ne peut pas l’améliorer. »
- Luis Palma
Identifier les angles morts et révéler ce qui coince
Les cartes mal conçues ont souvent le même défaut : elles sont faites sans celles et ceux qui vivent le processus au quotidien.
« Le plus grand piège, c’est de ne pas impliquer toutes les personnes concernées. Sans participation, on passe à côté d’une compréhension réelle. Il faut aussi un langage clair, partagé, pour que tout le monde comprenne la même chose lorsqu’il regarde une carte de processus », développe Luis Palma.
En effet, quand les équipes sont impliquées, tout change :
- Un langage visuel commun se développe
- Les pratiques informelles, souvent invisibles, émergent
- Les chevauchements, zones floues et points de friction sont identifiés
« C’est le cœur de l’intelligence collective », résume Luis Palma.
Et les résultats sont concrets. À la FCCQ, un simple exercice de cartographie du processus des comptes de dépenses a permis de visualiser, noir sur blanc, qui faisait quoi et à quel moment. Résultat : meilleure répartition des tâches, moins de frictions, et plus de clarté dans la collaboration.
Bien souvent, les tensions ne viennent pas d’un manque de bonne volonté… Mais d’un manque de visibilité ! En mettant en lumière les interdépendances réelles, la cartographie permet de repenser les rôles et d’apaiser bien des crispations.
Les types de cartographie : à chacun son itinéraire
Détour inutile ? Poste de péage trop lent ? Virage en double ? Voici les approches les plus courantes en cartographie des processus, avec des exemples concrets pour mieux visualiser.
Carte d’activités
- À quoi ça sert ? À distinguer ce qui crée de la valeur, de ce qui fait juste tourner en rond.
- Exemple : Le processus de recrutement. Entre l’affichage, la sélection, les entretiens et les validations, certaines étapes peuvent être simplifiées ou automatisées. Cette carte permet d’alléger le parcours sans perdre le cap. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, s’en est servi pour réduire ses délais de production en repérant des redondances dans certaines étapes.
Carte détaillée
- À quoi ça sert ? À zoomer sur chaque geste, chaque interaction, chaque point de friction.
- Exemple : Le traitement d’une plainte client. De la réception à la résolution, en passant par les suivis, tout peut être analysé pour réduire les va-et-vient et fluidifier l’expérience.
Carte SIPOC (Fournisseurs, Intrants, Processus, Extrants, Clients)
- À quoi ça sert ? À poser le décor complet d’un processus, en 5 éléments : d’où ça vient, ce qu’on reçoit, ce qu’on fait, ce qu’on produit, et pour qui.
- Exemple : Une demande d’achat. Fournisseurs, bons de commande, approbations, réception, facturation, etc. Tout y est. Le Mouvement québécois de la qualité recommande cette approche pour structurer les démarches d’amélioration continue dès le départ.
Carte à couloirs (ou Swimlane)
- À quoi ça sert ? À voir clairement qui fait quoi, quand, et dans quel ordre.
- Exemple : Le parcours d’intégration d’une nouvelle recrue. RH, gestionnaire, TI, sécurité, etc. Chacun.e a son rôle, mais la coordination fait toute la différence.
Chaîne de valeur
- À quoi ça sert ? À repérer les étapes qui ralentissent, alourdissent ou n’apportent pas de réelle valeur.
- Exemple : Le traitement des factures fournisseurs. Des validations en triple ? Des suivis inutiles ? Cette carte aide à épurer le processus sans nuire au contrôle. L’entreprise Rousseau Métal a notamment intégré cette approche dans une démarche Lean, inspirée du système Toyota, avec cartographie, Kanban, 5S… Et résultats au rendez-vous.
Carte actuelle vs future
- À quoi ça sert ? À comparer l’existant avec ce que l’on vise. Une vision avant/après, pour mieux planifier l’amélioration.
- Exemple : Le renouvellement des abonnements dans un OBNL. Avant : papier, suivis manuels. Après : plateforme numérique, rappels automatiques, clics rapides. Le progrès, version simplifiée.

Source : Infographie générée à l’aide de l’intelligence artificielle.*
Comment créer une carte de processus en 5 étapes
- Définir le point de départ
Identifier le processus à représenter, lui donner un titre, et réunir les parties prenantes. - Lister les étapes essentielles
Recenser les actions à effectuer, leur enchaînement logique, et les individus impliqués à chaque phase. - Poser les limites
Préciser quand et où le processus commence et se termine. Délimiter le périmètre d’analyse. - Tracer le parcours
Utiliser les symboles standards :
🔷 décision - 🟩 activité - 🔄 flux - 🟨 entrée/sortie - ⭕ début/fin - Relire, adapter, valider
Revoir la carte avec les personnes concernées. Vérifier la clarté, la cohérence et l’exhaustivité avant diffusion.
Bon à savoir
Plusieurs plateformes en ligne permettent de cartographier un processus :
- Draw.io: gratuit et efficace pour structurer visuellement ses processus.
- Lucidchart : interface intuitive, collaboration en temps réel.
- Miro : tableau blanc virtuel parfait pour brainstormer et structurer des parcours.
Lire une cartographie, ça s’apprend !
Chaque flèche, chaque couleur, chaque symbole a une fonction précise.
Pour qu’elle soit vraiment utile et pas juste une décoration sur un mur, encore faut-il que la cartographie soit lisible et partagée.
Voici quelques principes de base pour qu’une carte devienne un véritable outil de travail :
- Donner une légende claire et complète
- Utiliser des pictogrammes simples, cohérents et connus de toutes et tous
- Prendre le temps d’expliquer la carte aux personnes qui l’utilisent
- Laisser de l’espace à la discussion : questions, ajustements, améliorations
D’où viennent les symboles ?
Ces symboles ne sont pas choisis au hasard : ils proviennent du langage de modélisation unifié (UML), une norme internationale conçue pour représenter les processus de façon claire et structurée.
Pour en savoir plus : Lucidchart – Symboles et notation de cartographie des processus
Reconnaître les failles d’une mauvaise carte et l’améliorer
Si elle ne reflète pas la réalité du terrain, si elle ignore les goulots d’étranglement ou ne bouge jamais, une carte perd tout son intérêt.
« Il faut pouvoir l’ajuster comme on changerait d’itinéraire lors d’une randonnée si un sentier est bloqué », affirme Luis Palma.
« Pour rester pertinente, une cartographie des processus doit pouvoir être revue, discutée et ajustée régulièrement. »
- Luis Palma
Et pour que la carte reste adéquate, il faut aller plus loin :
- Identifier les points de contrôle critiques
- Repérer les causes réelles des blocages
- Proposer des solutions concrètes
- Équilibrer les charges de travail entre les équipes, sans simplement déplacer le problème ailleurs
Une cartographie bien menée met aussi en lumière ce qu’on ne voit pas toujours : les tâches à faible valeur ajoutée.
Contrôles redondants, validations inutiles, saisies en double, etc. Ce sont souvent ces petits grains de sable qui ralentissent toute la machine. Et là encore, les flux parlent : ils révèlent ce que l’habitude camoufle.
L’objectif n’est pas de corriger à la pièce, mais d’améliorer l’ensemble.
« Quand les processus sont bien définis, les gens sont plus motivés. Ils comprennent le sens de leur travail. »
- Luis Palma
Et c’est là que la magie opère : une dynamique d’équipe plus fluide, plus engagée, plus synergique.
Ne pas sous-estimer les raccourcis du terrain
Envoyer une demande directement au directeur, signer un document sans passer par l’approbation habituelle, éviter le formulaire prévu… Ces petits détours « maison » sont parfois devenus des réflexes. Des pratiques informelles, souvent perçues comme anodines, révèlent pourtant des limites bien réelles dans les processus officiels.
« Elles sont essentielles à documenter. Comprendre pourquoi elles existent permet soit de les intégrer, soit de les corriger intelligemment. D’où l’importance d’une procédure standard, base d’une amélioration continue », souligne Luis Palma.
IA + humain = le duo gagnant pour de bons processus
L’intelligence artificielle (IA) sait faire beaucoup : repérer les lenteurs, proposer des parcours plus efficaces, analyser des flux en quelques secondes, mais elle n’a ni contexte ni jugement.
« Il faut quelqu’un pour analyser, adapter, valider », rappelle Luis Palma. L’IA peut soutenir l’amélioration continue, mais elle ne remplace pas l’expérience humaine ni la compréhension du terrain.
Se munir d’une boussole pour avancer ensemble
La cartographie des processus est un levier puissant pour aligner les équipes, fluidifier les opérations et éclairer les décisions.
En rendant visibles les chemins empruntés, elle transforme les routines en opportunités d’amélioration. Dans un contexte où 70 % des entreprises québécoises ont innové entre 2020 et 2022, adopter une vision claire de ses processus devient un atout stratégique.
Luis Palma, pour sa part, se souvient d’une carte qui a tout changé pour son équipe, celle du processus d’une subvention. « Nous avons cartographié chaque volet, adapté la démarche aux différents programmes, et fait évoluer la carte en continu », explique-t-il.
De Accueillir un stagiaire à PCAN, et aujourd’hui Visées, chaque programme a bénéficié d’un ajustement fin, basé sur l’analyse terrain et la collaboration entre équipes, fait-il valoir.
Voici la preuve concrète que la cartographie n’est pas un exercice figé, mais un moteur d’adaptation et de cohésion.
Vous aimerez peut-être
-
Image

Employés et climat toxique en entreprise : ce qu’il faut savoir
-
Image

TDAH et travail : outils et stratégies gagnantes pour employeur averti
-
Image

Santé et sécurité au travail : nouvelles obligations pour les employeurs québécois
-
Image

Génération Z au travail : comment elle fait évoluer les pratiques RH
-
Image

10 conseils pour organiser des réunions efficaces
